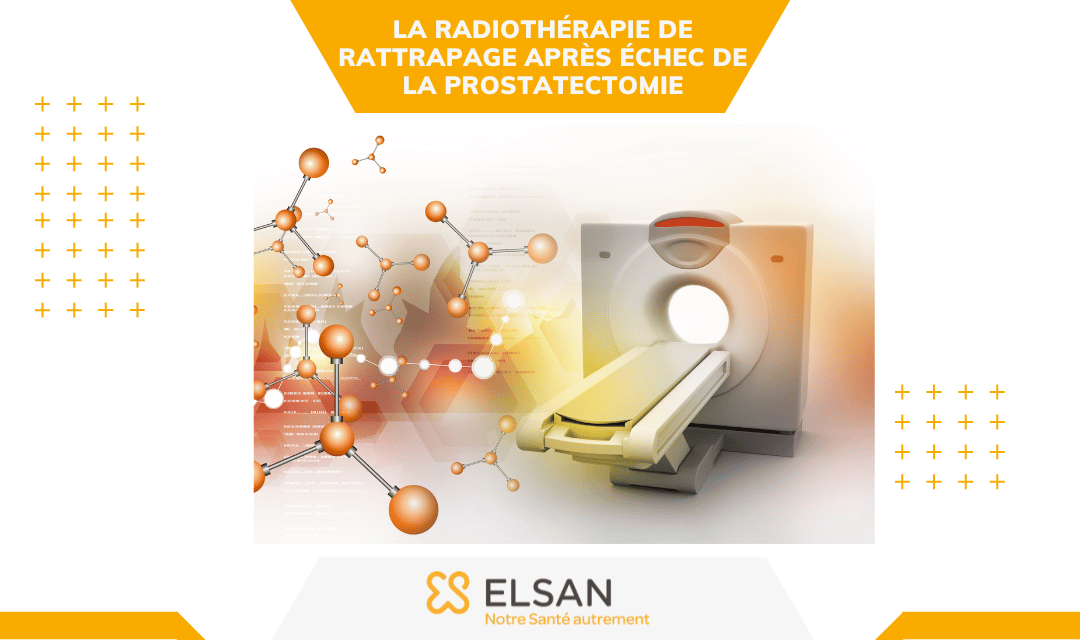Le cancer du côlon, ou cancer colorectal, est le plus fréquent chez l’homme après le cancer de la prostate et le cancer du poumon. Chez la femme, il n’est pas en reste, et arrive en deuxième position des cancers les plus fréquents après le cancer du sein.
Chez l’homme comme chez la femme, c’est un cancer de pronostic délicat, avec un taux de survie à cinq ans qui plafonne à 63 %, contre plus de 80% pour le cancer du sein, et environ 93% pour le cancer de la prostate.
Pour cause, le cancer du côlon est, encore aujourd’hui, trop souvent diagnostiqué à un stade avancé de son évolution. Pour espérer une prise en charge précoce offrant de meilleures chances de guérison, il est important de savoir en reconnaître les tout premiers symptômes, mais aussi de se faire dépister régulièrement.
Présentation du cancer du côlon (cancer colorectal)
Voici quelques point-clés sur ce cancer :
- Le cancer du côlon est une tumeur maligne qui se développe à partir des cellules des tissus du côlon.
- S’il est volontiers regroupé avec le cancer du rectum sous le nom de cancer colorectal, c’est parce qu’il s’agit de tumeurs très semblables, localisées dans les mêmes zones.
- Le côlon et le rectum sont composés de tissus similaires, et la frontière entre ces deux organes est indistincte.
- On estime que 80 % des cancers du côlon se développent à partir d’une tumeur bénigne : le polype adénomateux, ou adénome.
- La présence de polypes adénomateux n’est pas systématiquement synonyme de cancer du côlon pour autant, et seuls 2 % à 3 % de ces tumeurs bénignes évolueront en lésions malignes, le plus souvent très lentement, sur une dizaine d’années.
- Plus la tumeur est diagnostiquée et traitée tôt, meilleures sont les chances de guérison complète du patient.
La présence de polypes adénomateux, même non cancéreux, devrait être surveillée de près, voire faire l’objet d’une ablation préventive. Cette prise en charge précoce n’est possible que lorsque le patient se fait correctement dépister, car le cancer du côlon ne cause pas de symptômes à ses prémices, et a donc peu de chances d’être découvert tôt s’il n’est pas spécifiquement recherché.
À cet effet, il existe des tests immunologiques visant à déceler la présence de traces de sang dans les selles, potentiellement annonciatrices d’un cancer du côlon, que chaque personne peut réaliser chez elle.
Dans le cadre des opérations de dépistage organisées en France depuis 2008, tous les hommes et toutes les femmes âgés de 50 ans à 74 ans sont vivement encouragés à effectuer ce test tous les deux ans. Si le test révèle la présence de sang dans les selles, il est essentiel de consulter un spécialiste, bien que cela ne soit pas nécessairement synonyme d’un cancer du côlon.
Lire aussi notre article sur le dépistage du cancer colorectal
Symptômes du cancer du côlon
Les premiers symptômes du cancer du côlon
Habituellement, le cancer du côlon évolue silencieusement, parfois des années durant, avant de provoquer le moindre symptôme. Lorsque les symptômes apparaissent, il s’agit essentiellement de douleurs abdominales, d’une modification du transit intestinal et de la présence de sang dans les selles.
Les douleurs abdominales peuvent être plus ou moins intenses, et très localisées ou, à l’inverse, diffuses. Elles peuvent parfois faire penser à des crampes intestinales causées par des ballonnements, et ne poussent pas toujours à consulter.

Une modification du transit intestinal peut se traduire par une constipation ou une diarrhée soudaine et prolongée. Une alternance entre diarrhée et constipation peut également être observée. La présence de sang dans les selles, quant à elle, est parfois imperceptible. En effet, le sang n’est pas toujours rouge vif, mais peut-être noir ou brun, se confondant avec la couleur des excréments.
Le patient atteint d’un cancer du côlon peut également ressentir une envie constante d’aller à la selle ou des sensations inhabituelles au moment d’éliminer. À mesure que le cancer évolue, il peut former une masse palpable au niveau de l’abdomen. L’état de santé général du patient peut se détériorer, et on observe parfois un amaigrissement, une fatigue inexpliquée, une anémie et/ou des épisodes de fièvre.
Les symptômes du cancer du côlon à un stade avancé
Le cancer du côlon en phase avancée se caractérise par une constellation de signes cliniques dont l’expression varie en fonction de la progression locale et de l’extension à distance du cancer. Les manifestations cliniques sont souvent corrélées à la taille de la néoplasie et à l’implication d’organes secondaires suite à une dissémination hématogène ou lymphatique.
Des symptômes tels que des modifications du transit intestinal, l’alternance de diarrhée et de constipation, peuvent indiquer une obstruction partielle ou complète du côlon. La présence de sang rouge vif dans les selles, peut signaler une lésion saignante du côlon. De même, des douleurs abdominales, qui peuvent être diffuses ou localisées, souvent de nature crampoïde, sont fréquemment rapportées.
Lorsque la maladie progresse vers le système osseux, des douleurs osseuses, des risques de fractures pathologiques, une hypercalcémie et des symptômes neurologiques peuvent survenir en cas d’atteinte vertébrale. Des manifestations pulmonaires ou une douleur thoracique sont possibles lors de métastases pulmonaires.
La fatigue et la faiblesse, qui vont au-delà de la simple lassitude, peuvent aussi être des symptômes. Elles résultent parfois d’un saignement interne de la tumeur, qui entraîne une perte de fer et d’hémoglobine, essentiels à l’énergie du corps. Si vous vous sentez constamment épuisé sans raison apparente, il est important de le signaler à votre oncologue et/ou votre médecin traitant.
Des douleurs abdominales ou une sensation de ballonnement peuvent survenir si une tumeur empêche les matières de passer normalement, ce qui peut rendre difficile l’évacuation complète de l’intestin et provoquer une sensation de lourdeur ou de plénitude.
Un symptôme particulièrement alarmant est une perte de poids inexpliquée, surtout si elle est significative et que vous n’avez pas modifié votre régime alimentaire. Ce signe peut indiquer que le cancer affecte le métabolisme de votre corps.
Dans certains cas, des nausées et des vomissements peuvent également être présents, surtout si la tumeur crée une obstruction dans le système digestif.
Il est impératif d’adopter une démarche diagnostique rigoureuse face à ces symptômes, incluant des examens d’imagerie, une coloscopie et des analyses biologiques, pour établir un diagnostic et optimiser la prise en charge thérapeutique. La surveillance clinique et l’investigation diagnostique doivent être adaptées à chaque patient, en fonction de l’évolution de la symptomatologie et des comorbidités associées.
Diagnostic du cancer du côlon
Le diagnostic du cancer du côlon est souvent tardif malgré le programme de dépistage organisé établi en France depuis 2008. Il débute habituellement par un examen clinique effectué par un médecin généraliste dans le cadre d’une consultation de routine, pour des maux de ventre ou suite à la présence de sang dans les selles.
Des examens complémentaires, comprenant un toucher rectal et une coloscopie, permettent ensuite d’avérer la présence de masses potentiellement cancéreuses. La coloscopie permet d’explorer la totalité du colon pour rechercher toutes les tumeurs potentielles et effectuer des prélèvements cellulaires (biopsie).
Les cellules tumorales prélevées lors de la biopsie sont analysées en laboratoire au microscope. L’analyse anatomopathologique de ces cellules, qui consiste en l’évaluation de leur morphologie, permet d’avérer la malignité de la tumeur et de catégoriser le cancer. En fonction des résultats de l’analyse anatomopathologique des cellules tumorales, l’équipe médicale pourra évaluer le stade et le grade du cancer afin d’établir un pronostic et un protocole de traitement adapté.
Dans certains cas, il arrive que le diagnostic du cancer du côlon passe par des examens d’imagerie médicale complémentaires pour guider la biopsie ou collecter davantage d’informations sur l’étendue des tumeurs. De fait, la coloscopie se révèle parfois impossible, ou insuffisante pour offrir une vision satisfaisante des lésions.
Enfin, si le cancer du côlon est diagnostiqué à un stade avancé de son évolution, d’autres examens permettront de rechercher d’éventuelles métastases au niveau d’organes distants. Le cancer du côlon fait partie des cancers les plus fréquents en France, mais il reste encore souvent diagnostiqué trop tardivement, tant du fait de la méconnaissance des personnes à risque au sujet de cette maladie que de l’embarras que peuvent susciter les examens de dépistage.
Les progrès de la médecine ont toutefois permis de rendre les examens de dépistage plus accessibles, notamment grâce aux tests immunologiques que chacun peut réaliser chez soi, dans l’intimité de son domicile.
Il est hautement recommandé à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans d’échanger avec leur médecin sur les dangers du cancer du côlon, et de mettre en œuvre une stratégie de dépistage adaptée à leur niveau de risque.